Les illusions qui naissent dans le cerveau
- madrid66250
- 17 févr. 2015
- 5 min de lecture
Poursuivons le passage de l’image : nous avons vu que l’image arrive au niveau de la rétine, celle-ci va la transformer en message nerveux qui seront ensuite acheminés vers le nerf optique. Ce dernier envoie toutes les informations au cerveau.
a) Comment une image parvient-elle sur le cerveau ?
Les messages nerveux sont véhiculés par les 2 nerfs optiques qui se croisent au niveau du chiasma optique. Ce croisement a une conséquence importante puisque : un objet situé à droite de notre champ de vision, se trouvera au niveau de l’aire visuelle gauche et vice-versa.
Ils sont ensuite relayés par les corps genouillés latéraux qui mènent au cortex visuel primaire. Enfin, le champ visuel de l’œil droit et le champ visuel de l’œil gauche se réunissent et se fusionne grâce au CGL (corps géniculé 2 latéral) afin de traiter l’information visuelle.

Les CGL vont ensuite rejoindre leur cible principale : le cortex visuel occipital. C’est là que l’image va commencer à être reconstituée. Celui-ci est composé d'une trentaine de régions différentes ou aires corticales. Toutes travaillent main dans la main pour élaborer une image unique et nette. Mais seul le rôle de quelques-unes est bien compris :
V1, est l'aire visuelle primaire. C'est la plus importante, sans elle, on serait aveugle. Elle se situe dans la partie la plus postérieure du cerveau (lobe occipital).V1 fait une première analyse des informations recueillies (forme, couleur, mouvement) et les distribue ensuite aux autres aires.
V2, qui reçoit beaucoup de " courrier " de la part de V1, trie les informations de façon encore plus fine. Cette aire traite à la fois des contours (cercle, carré, ovale, etc.), de l’orientation (horizontale, verticale), des textures (lisse, rugueux, etc.) et des couleurs.
Puis les autres aires entrent en jeu, chacune dans leur spécialité, en même temps et sur le même rythme.
V3 analyse les formes en mouvement et apprécie les distances.
V4 s'occupe du traitement des couleurs et des formes immobiles.
V5, joue un rôle dans la perception des mouvements.
Après avoir traversé les aires visuelles, les messages nerveux se séparent et suivent deux trajets différents :
Une voie ventrale, spécialisée afin de reconnaitre l’objet. Elle est surnommée « voix du quoi » probablement pour déterminer la nature de ce que nous voyons
Une voie dorsale, dans le but de déterminer où se trouve l’objet ; c’est pourquoi elle est également appelé « voix du ou ».
b) Que sont les illusions géometriques ?
Les illusions géométriques sont formées par des figures géométriques (arc, flèche, rond, carré…). Elles provoquent des erreurs d’estimation, de dimension, d’interprétation, de courbure et de direction. C’est au début du XXe siècle que de nombreuses illusions géométriques ont été découvertes notamment par Delboeuf, Hering, Müller-Jyer, Titchener.
1. Quel cercle rouge est le plus grand ?

Explication : Ici, l’élément «test » entouré d'éléments « inducteurs » plus petits paraît plus grand tandis qu’un élément « test » entouré d'éléments «inducteurs» plus grands paraît plus petit. Ce phénomène est dû à un effet de contraste. Ce contraste apparaît quand la différence entre l'élément « inducteur » et l'élément « test » est importante.
2. Quelle flèche est la plus longue ?

Explication : Ici, les extrémités des flèches sont les éléments "inducteurs" et les traits verticaux, les éléments "tests". Nous avons tendance à modifier la perception de la longueur de segments en fonction de leur orientation.
3. Les lignes du damier sont-elles parallèles ?

Explication : L’effet de distorsion est dû au positionnement des carrés noirs et blancs, en ondulation régulière, qui crée une sorte de vague horizontale, ce qui donne une certaine direction aux droites. De plus, l’illusion serait impossible si les carrés n’étaient pas entourés d’une teinte de gris intermédiaire entre le blanc et le noir, qui représentent les droites distordues. Cette illusion est due à des mauvaises connections entre nos air visuelles qui détériorent donc notre perception. Cette alternance des zones noircies entre chaque bande est l’élément inducteur de cette illusion et les éléments tests sont les bordures de chaque bandelette de papier qui semblent être courbées plutôt que droites.
4. Les droites sont-elles parallèles ?

Explication : les lignes droites jouent ici le rôle d'élément test, car c'est leur position qui va être mal interprétée par notre cerveau et les éléments inducteurs sont les petits segments qui coupent les lignes : ce sont eux qui induisent le cerveau en erreur. Ce dernier perçoit mal la direction des grandes lignes, qui dans la réalité sont parallèles. Il a le réflexe de ramener tous les angles vers les angles droits dominants dans notre vie de tous les jours. Ainsi, il chercherait constamment à augmenter la mesure d'un angle aigu, et faire diminuer celle d'un angle obtus, pour se rapprocher au maximum de l'angle droit. Dans l'illusion de Zöllner, le cerveau chercherait à créer des angles droits entre les petits segments et les grandes lignes, et modifierait ainsi la position de ces dernières.
c) Que sont les illusions artistiques ?
Les illusions artistiques ne reposent pas uniquement sur une faiblesse du cerveau, elles ont été créées pour leur beauté ou pour surprendre par leur extravagance. L'aire primaire reçoit le signal tel que l'œil perçoit l'image. L'aire met ensuite en relation cette sensation avec l'aire d'association qui va analyser l'image et lui donner un nom. Cet air a donc un rôle de mémoire. Ainsi, en voyant une image inconnue mais qui ressemble fortement à une image enregistrée dans l'aire d'association, le cerveau n'arrive pas à interpréter l'image ou l'interprète mal et donc ne la comprend pas forcément. Dans ce cas d’illusion, le vécu et les émotions ont un rôle important car nous ne pouvons pas voir tous la même chose d’un premier coup d’œil. Il existe deux grandes catégories d’illusions artistiques :
Les illusions portant sur l'ambiguïté c'est-à-dire qu’un dessin comportant au moins deux interprétations possible, il est parfois difficile pour l’observateur de passer d’une interprétation à l’autre notamment lorsque nous ne connaissons pas les deux interprétations possibles mais notre cerveau est dans l'incapacité complète de saisir les deux images en même temps.
Que voyez-vous une jeune femme ou une vieille ?

Explication : L'image comporte deux interprétations possibles, soit voir la jeune femme soit la vieille sorcière. Les deux réponses sont exactes, mais le vécu et le quotidien de chacun influence la décision de notre cerveau.
Les illusions qui jouent sur l'impossibilité c'est-à-dire que les interprétations qu'on peut tirer d’un dessin sont incohérentes et donc les objets dessinés ne pourraient pas exister. Ces objets sont plus communément appelés des figures impossibles, elles s'appuient souvent sur la profondeur, les ombres et les différents points de vue pour proposer des objets, des situations ou des paysages qui apportent une confusion.
Combien de pattes possèdent l'éléphant ? 4 ou 5 pattes ?

Explication : Vous pouvez toujours recompter, suivant les interprétations, cet éléphant a 4 ou 5 pattes. Cet éléphant est évidemment imaginaire : c'est une figure impossible, les deux parties différentes du dessin suscitent des interprétations incompatibles entres elles.
Que sont les illusions de contraste ?
Ces illusions jouent sur l’influence qu’ont les couleurs entre-elles pour donner aux couleurs des apparences inattendues. En effet, la luminosité, l’environnement, et la juxtaposition des couleurs ont une influence sur l’interprétation des contrastes par le cerveau qui a toujours tendance à les accentuer. C’est ainsi qu’une tâche claire paraîtra encore plus claire dans un environnement sombre et vice-versa.
Quel carré est le plus foncé ? le A ou le B ?

Explication :
Il existe plusieurs explications concernant cette illusion :
D'une part, il y a ici un effet bien connu d'illusion de contraste : le cerveau distingue les couleurs par rapport au milieu environnant. Ainsi la zone A parait plus foncé car elle est entourée de carreaux clairs et à l'inverse, la zone B paraît plus clair du fait des carreaux plus foncés autour d'elle.
D’autre par notre vécu joue sur notre perception. En effet nous connaissons bien les damiers. Ainsi dans l'ordre logique du damier, la zone B appartient à la suite des carreaux clairs. Pourtant du fait de l'ombre, la zone B est bien plus foncée que lesautres carreaux clairs. Le cerveau corrige donc la nuance apportée par l'ombre et "éclaircie" la zone B.

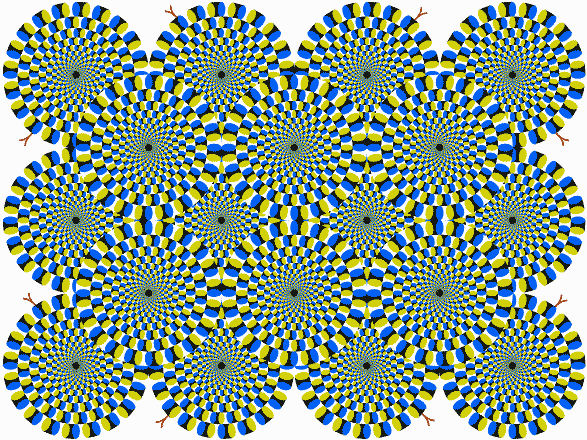









Comentários